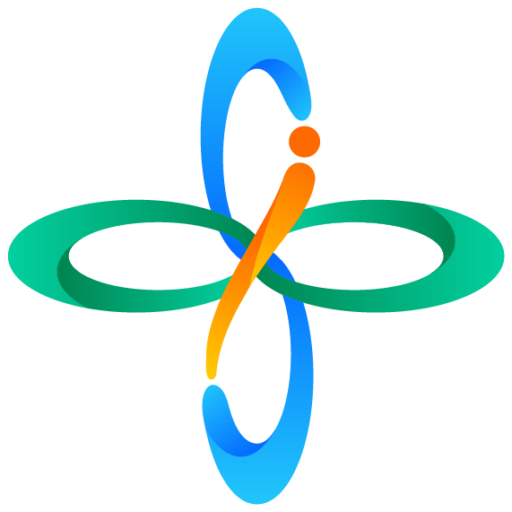Pourquoi ne pas se préparer à la gestion de crise peut coûter très cher – quand les secousses du monde rencontrent les fragilités humaines
Il existe un sentiment tenace, presque universel : tant que rien de grave n’est arrivé, pourquoi s’en inquiéter ? Nombre d’organisations vivent encore avec cette idée rassurante que la crise est un événement exceptionnel, rare, presque théorique. Une anomalie qui ne pourrait frapper qu’ailleurs, dans un autre secteur, une autre ville, une autre époque. Pourtant, la réalité contemporaine raconte une histoire bien différente.
Les crises sont devenues plus rapides, plus globales, plus intriquées. Elles se jouent des frontières comme des certitudes. Elles surgissent parfois en quelques minutes, sans prévenir, sous la forme d’une décision politique lointaine, d’une cyberattaque, d’un dérapage médiatique, d’un incident logistique ou d’un imprévu technique. Mais l’essentiel n’est pas là. Ce qui détermine la violence d’une crise n’est pas tant l’événement qui la déclenche que l’état de l’organisation au moment où elle la traverse.
Le monde extérieur : un théâtre de secousses rapides et imprévisibles
Les récents changements géopolitiques, à l’image des nouvelles taxes douanières décidées aux États-Unis, rappellent à quel point l’économie mondiale repose sur des équilibres fragiles. Une mesure prise à Washington peut faire grimper le coût d’un matériau essentiel en Suisse. Un changement de réglementation en Asie peut désorganiser une chaîne d’approvisionnement entière. Un conflit localisé peut bouleverser les marchés internationaux.
L’entreprise ou l’institution la plus locale, la plus ancrée dans son territoire, se trouve ainsi exposée à des forces qui la dépassent. Les frontières ne protègent plus des secousses globales. Mais cette exposition accrue n’est pas ce qui coûte le plus cher. Le coût réel naît de l’incapacité à y répondre, faute d’une préparation collective, d’une vision claire ou d’une cohésion suffisante.
Les fragilités internes : là où la crise prend racine
Il arrive qu’un incident mineur se transforme, presque sans prévenir, en crise majeure. Ce phénomène n’a rien d’une fatalité. Le plus souvent, il révèle simplement que l’organisation était déjà fragilisée de l’intérieur. Les signes sont connus : des équipes épuisées, un climat relationnel tendu, des responsabilités mal définies, une communication étouffée, une perte de sens insidieuse, des décisions prises dans l’urgence permanente, des processus que plus personne ne maîtrise vraiment.
Lorsqu’une équipe manque de sérénité ou de clarté, elle devient naturellement plus vulnérable. Le moindre imprévu prend alors des proportions inattendues. Ce n’est pas l’ampleur de l’événement qui est en cause, mais l’amplificateur humain que constituent la fatigue, la peur, l’incertitude ou le manque de confiance. Une organisation fragilisée n’a pas besoin d’une grande crise pour s’effondrer. Il lui suffit d’une secousse ordinaire.
L’effet miroir : quand l’extérieur rencontre l’intérieur
La véritable crise naît presque toujours de la rencontre entre deux mouvements : un choc extérieur — inattendu, soudain, souvent inévitable — et un terrain intérieur — parfois négligé, souvent sous-estimé. Une hausse imprévue des coûts, un retard d’approvisionnement, une cyberattaque ou un événement médiatique peuvent être absorbés si l’équipe est solide. Mais ces mêmes chocs deviennent destructeurs lorsqu’ils frappent une organisation déjà épuisée, divisée ou inquiète.
Là se joue le coût réel d’une crise : dans les tensions qui se cristallisent, dans les erreurs qui se multiplient, dans la perte de confiance, dans le temps gaspillé, dans les décisions que l’on regrettera plus tard. Les crises ne coûtent pas cher parce qu’elles surviennent. Elles coûtent cher parce que nous n’y étions pas prêts.
La préparation : une culture plus qu’une procédure
On imagine parfois qu’un plan de gestion de crise se résume à un classeur épais, rempli de procédures techniques. Mais se préparer signifie bien davantage : c’est créer un espace mental, une maturité collective, une capacité à voir plus loin que l’urgence du moment. C’est offrir aux équipes des repères, donner au leadership un rôle d’ancrage, clarifier les responsabilités, instaurer un langage commun, cultiver la confiance, et surtout, pratiquer. S’entraîner, encore et encore, à réfléchir ensemble sous contrainte, à décider dans l’incertitude, à communiquer sans se perdre. Cette préparation n’élimine pas les crises. Elle transforme la manière de les vivre. Elle permet aux organisations de faire face avec calme, avec lucidité, avec caractère.
Les organisations résilientes ne sont pas celles qui n’ont pas de crises. Ce sont celles qui refusent de les affronter les yeux fermés. Ne pas se préparer, c’est laisser le hasard gouverner les moments les plus décisifs. C’est accepter que la fatigue, la confusion ou la panique soient les véritables décideurs d’une situation critique. C’est laisser au monde extérieur plus de pouvoir qu’il n’en mérite.
Se préparer, à l’inverse, c’est choisir la responsabilité. C’est faire le pari de l’intelligence collective et de la force humaine. C’est reconnaître que, face au tumulte du monde, la cohérence interne est notre meilleure protection. Et qu’une équipe soudée, entraînée, confiante, peut transformer n’importe quelle secousse en un tremplin vers davantage de maturité. Dans un contexte où les risques exogènes gagnent en intensité et où les fragilités humaines s’expriment plus fortement que jamais, la préparation n’est pas un acte technique. C’est un acte de sagesse. Un acte de lucidité. Et, peut-être, un acte de courage.